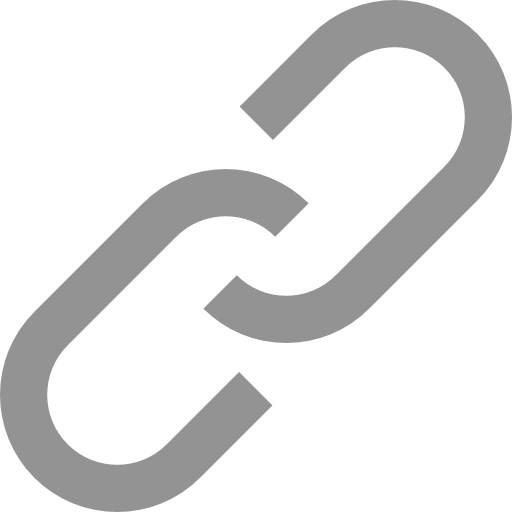Cette nouvelle étude montre de manière inattendue, une hybridation supplémentaire entre les Papous et un des groupes de Denisova, suggérant que ce dernier vivait en Nouvelle-Guinée ou dans les îles proches. « Les gens pensent en général que les Dénisoviens vivaient très au nord sur le continent Asiatique » explique François-Xavier Ricaut, chercheur CNRS au laboratoire Evolution et Diversité Biologique de Toulouse. « Nos travaux montrent en fait que le centre de la diversité de ces homininés archaïques n’était pas l’Europe ou le Grand Nord, mais l’Asie tropicale ».
Il était déjà évident que les îles d’Asie du Sud-Est et de Nouvelle-Guinée représentaient un lieu particulier, avec des individus ayant davantage d’ADN de ces homininés archaïques que n’importe où ailleurs sur Terre. La région devient essentielle afin de comprendre l’évolution d’Homo sapiens en dehors d’Afrique et de nouveaux chapitres inconnus de cette histoire s’ouvrent désormais.
Pour mettre en lumière cette histoire inédite, cette équipe internationale a extrait les haplotypes archaïques de 161 génomes humains provenant de 14 îles d’Asie du Sud-Est et de Nouvelle-Guinée. Leurs analyses ont révélé de grands fragments d’ADN dont la présence ne peut s’expliquer par un seul événement d’introgression entre Denisova et l’Homme moderne dans la région. En effet, les populations actuelles papoues possèdent des centaines de variants génétiques provenant de deux lignées dénisoviennes profondément divergentes, qui se seraient séparées l’une de l’autre il y a plus de 350 mille ans.
En dépit de l’importance et de l’innovation de ces travaux, les chercheurs soulignent le manque d’investissement de recherche engagé jusqu’à présent dans cette partie du monde. Afin d’illustrer ce faible investissement vis-à-vis du fort potentiel de recherche, notons que de nombreux participants de l’étude vivent en Indonésie, pays de même superficie que l’Europe avec la quatrième population mondiale.
En effet, à part quelques génomes reportés dans une étude sur la diversité globale publiée en 20161 dans la revue Nature, ce nouvel article est le premier à rendre compte d’une diversité représentative de génomes indonésiens. Par ailleurs, un fort biais a existé dans les études des homininés archaïques, celles-ci ne se focalisant que sur l’Europe et le nord de l’Eurasie, l’ADN humain étant mieux conservé par le froid. Cette approche a occulté la représentation globale à la fois dans les données génomiques anciennes et modernes, expliquent les chercheurs. « Cependant, nous pensons que nous n’avons pas encore réalisé l’importance du biais que cela introduit dans les interprétations scientifiques – comme ici, celle de la distribution géographique des populations d’homininés archaïques », rapportent MP Cox et FX Ricaut.